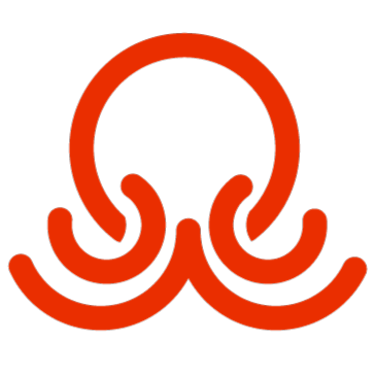Voie Atypique 🐙, des repères pour mieux comprendre la diversité cognitive
Pensée en arborescence : une clé pour comprendre le HPI ?
La "pensée en arborescence" est souvent présentée comme une spécificité du haut potentiel intellectuel (HPI). Selon ce concept, les idées se développeraient simultanément, de manière foisonnante. Popularisée en France dans les années 2000, cette image séduit par sa force explicative. Mais que nous dit la recherche scientifique sur ce concept ?
HPI
Claire de Voie Atypique 🐙
10/29/2025


Le terme de "pensée en arborescence" a été popularisé en France par la psychologue clinicienne Jeanne Siaud-Facchin, notamment dans son livre Trop intelligent pour être heureux ? (Odile Jacob, 2008). Elle y décrit un mode de pensée présenté comme caractéristique des personnes à haut potentiel intellectuel (HPI), où les idées jaillissent dans plusieurs directions, rebondissant de l'une à l’autre comme les "branches" d’un arbre. Cette pensée foisonnante et associative serait si créative qu'elle en deviendrait difficile à structurer, s'opposant ainsi à une pensée linéaire et séquentielle, considérée propre aux non-HPI.
Cette image peut refléter le vécu de certaines personnes HPI, mais au-delà de la métaphore, que nous apprennent les données scientifiques actuelles ?
Ce que dit la science
À ce jour, aucune étude publiée dans une revue à comité de lecture, que ce soit en psychologie cognitive ou en neurosciences, n’a validé l’existence d’une "pensée en arborescence" spécifique, ou non, aux personnes HPI.
La "pensée en arborescence" apparaît donc comme une métaphore descriptive, pouvant être utile dans le dialogue thérapeutique, mais qui ne correspond pas à un concept opérationnel mesurable par la recherche scientifique.
Les connaissances actuelles sur le HPI s’appuient sur des outils standardisés (WISC-V, WAIS-IV, etc) et montrent une grande variabilité des profils cognitifs. Les différences observées entre HPI et non-HPI sont statistiques : elles ne permettent pas de définir un fonctionnement cognitif qualitativement différent (Ramus, 2018).
Un neuromythe faisant consensus dans la recherche
Un neuromythe désigne une croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau, souvent issue d'une mauvaise interprétation ou d'une extrapolation excessive de données scientifiques.
Le concept de "pensée en arborescence" correspond à cette définition : largement diffusé auprès du grand public, il n'a pas été validé empiriquement et contribue à structurer certaines représentations sociales autour du HPI.
Cela ne signifie pas que les personnes qui s’y reconnaissent se trompent sur leur ressenti. Leur expérience personnelle est bien réelle, et il est légitime de chercher à donner du sens à son fonctionnement cognitif. Toutefois, la démarche scientifique implique de distinguer ce qui relève d'une expérience subjective de ce qui repose sur des observations rigoureusement validées.
Comment expliquer la popularité de ce concept ?
De nombreuses personnes HPI rapportent une pensée rapide et foisonnante. La métaphore de la "pensée en arborescence" fournit une explication intuitive à ce ressenti. Or, ce type d'identification peut être influencé par un biais de confirmation : on adopte une idée parce qu'elle résonne avec son expérience personnelle, sans vérification externe de sa validité.
Par ailleurs, la simplicité et l'image de la "pensée en arborescence" peuvent renforcer son attrait, en raison d'un biais de fluidité cognitive, aussi appelé effet de vérité illusoire : plus une idée est facile à comprendre ou à mémoriser, plus on a tendance à la juger vraie, plausible ou familière, indépendamment des preuves qui la soutiennent.
Par ailleurs, les personnes qui consultent dans un cadre clinique pour un HPI rencontrent souvent des difficultés et sont parfois en souffrance. Cela peut créer un biais d'échantillonnage : on généralise à l'ensemble des HPI des observations issues d'un sous-groupe non-représentatif, renforçant ainsi certaines idées reçues.
Un concept culturellement situé
Le concept de "pensée en arborescence" est spécifiquement français. On ne le retrouve pas dans la littérature scientifique internationale sur le "giftedness". Les chercheurs préfèrent utiliser des notions plus opérationnelles comme la pensée divergente et la pensée convergente, introduites par Joy Paul Guilford dès les années 1950 :
La pensée divergente consiste à générer de multiples idées à partir d'une situation donnée (brainstorming).
La pensée convergente cherche à trouver la solution la plus pertinente à un problème donné.
Ces deux processus de pensée ne s'opposent pas : ils coexistent chez chacun d'entre nous et sont mobilisés en fonction de la tâche, du contexte, ou des compétences. La créativité, par exemple, implique souvent une alternance fluide entre pensée divergente et convergente (Runco, 2008).
La méta-analyse de Kim (2008) montre d’ailleurs une corrélation modeste mais significative entre intelligence et pensée divergente. Ce lien reste toutefois statistique et ne suffit pas à démontrer l’existence d’un fonctionnement qualitativement différent.
La "pensée en arborescence", un neuromythe : alors, que sait-on vraiment des profils HPI ?
Le HPI se définit généralement par un score total de Quotient Intellectuel (QI) supérieur à 130 et correspond statistiquement à environ 2,28 % de la population. Ces personnes présentent une efficience intellectuelle supérieure à la moyenne et elles peuvent manifester une aisance de raisonnement et une capacité d'apprentissage. Cependant, ces caractéristiques ne permettent pas à elles seules d'identifier un HPI : seule une évaluation rigoureuse par un test d’intelligence standardisé le permet (Grégoire, 2023).
Jacques Grégoire rappelle d'ailleurs que le seuil de 130 est un arbitrage statistique, et non un seuil clinique.
Franck Ramus (2018) confirme ce constat : les différences observées sont principalement liées à des facteurs quantitatifs (activation accrue de certaines régions cérébrales, connectivité interhémisphérique plus développée, volume cérébral légèrement supérieur), sans qu’elles impliquent un fonctionnement cognitif qualitativement différent.
En outre, le HPI n'est pas d'une catégorie uniforme : certains ont un profil cognitif très équilibré (HPI homogène), d'autres des profils cognitifs contrastés (HPI hétérogène), évalués à travers les indices de tests tels que le WISC et le WAIS (compréhension verbale, raisonnement perceptif, mémoire de travail, vitesse de traitement).
Sans "pensée en arborescence", quelle place pour la créativité chez le HPI ?
La créativité peut se définir comme la capacité à réaliser une production qui soit nouvelle, originale, tout en respectant les contraintes imposées par la situation ou le problème (Besançon et Lubart, 2015).
Les études sur le lien entre intelligence et créativité montrent des résultats variables, mais un consensus relatif se dessine : il existe une corrélation positive très modérée entre efficience intellectuelle et créativité. Toutefois, certaines études mettent en évidence un cas particulier : au-delà d'un QI d'environ 120, cette corrélation tend à s'atténuer ou à disparaître.
Autrement dit, l'intelligence est une condition nécessaire, mais non suffisante, à la créativité.
De plus, cette tendance statistique n'exclue pas de fortes variations entre les individus HPI. Cette disparité pourrait s'expliquer par une variabilité dans des facteurs autres que le QI, tels que les choix de stratégies d'analyse et de résolution de problème, et les connaissances.
Des pensées foisonnantes qui s'apparentent parfois aux manifestations du TDAH
Un flux de pensée difficile à canaliser, pouvant traduire une distractibilité accrue ou une surcharge cognitive, peut parfois être interprété comme une "pensée en arborescence". Or, ces manifestations correspondent à certains critères du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), défini dans le DSM-5 et la CIM-11.
Un diagnostic différentiel rigoureux reste donc essentiel, afin d'éviter toute confusion entre une métaphore descriptive et un trouble neurodéveloppemental potentiellement sous-jacent.
L’étude de Minahim et Rohde (2015) a précisément examiné la présence de symptômes de TDAH chez des enfants et des adultes HPI. Chez les adultes HPI, 37,8% présentaient un score positif au dépistage du TDAH contre 13.4% dans le groupe contrôle (non-HPI). Chez les enfants, la fréquence atteignait 15,38% contre 7,69% dans le groupe contrôle. Les auteurs concluent sur l'existence d'une prévalence élevée des symptômes du TDAH observée chez les personnes HPI.
Conclusion
La "pensée en arborescence" n'est pas un concept scientifique reconnu et fait partie des neuromythes sur les HPI. Elle peut aider à décrire un ressenti, mais elle ne reflète pas un mode de fonctionnement cognitif qualitativement différencié.
Ce constat ne vise pas à nier les difficultés ou les singularités des personnes HPI, mais à favoriser une compréhension nuancée et fine, en distinguant expérience subjective et donnée objectivable. Mieux connaître les mécanismes de la pensée, c’est aussi mieux accompagner chacun dans son parcours cognitif et personnel.
Références détaillées ci-dessous.
Bibliographie:
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
Besançon, M. & Lubart, T. (2015). La créativité de l'enfant. Evaluation et développement. Paris : Mardaga
Clobert, N. & Gauvrit, N. (2021). Psychologie du haut potentiel : comprendre, identifier, accompagner. De Boeck Supérieur.
Dolidon, M. (2024). HPI : L'intelligence n'est pas une maladie. Tom Pousse.
Grégoire, J. (2023). Evaluer l'intelligence. De Boeck Supérieur.
Kim, K. H. (2008). Meta-Analyses of the Relationship of Creative Achievement to Both IQ and Divergent Thinking Test Scores. The Journal of Creative Behaviour, 42(2), 106–130.
Minahim, D., & Rohde, L. A. (2015). Attention deficit hyperactivity disorder and intellectual giftedness: A study of symptom frequency and minor physical anomalies. Brazilian Journal of Psychiatry, 37(4). https://doi.org/10.1590/1516-4446-2014-1489
Organisation mondiale de la santé (2022). Classification international des maladies (11e révision) : Chapitre sur les troubles neurodéveloppementaux. Genève : Organisation mondiale de la Santé.
Ramus, F. (2018). Les surdoués ont-ils un cerveau qualitativement différent? A.N.A.E., 30(154), 281‑287.
Rebecchi, K. (2022). La neurodiversité. L'Harmattan.
Runco, M. A. (2008). Reasoning and Personal Creativity. In J.C Kaufman & J. Baer (Eds.). Creativity and Reason in Cognitive Development (pp. 99-106). New York: Cambridge University Press.